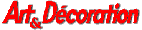
Célébrée lorsqu'on y associe le nom de Picasso,
décriée quand on évoque les grands déballages
pour touristes, la céramique de Vallauris reste encore méconnue.
Liée à l'aventure de la Côte d'Azur depuis 1900,
elle a le goût des vacances et du soleil.
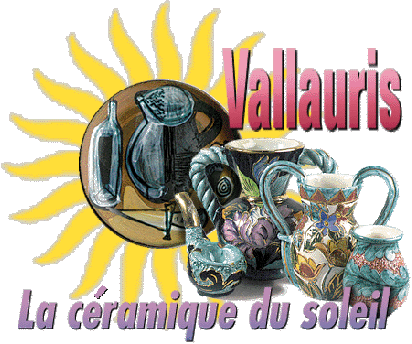
L'assiette ci-dessus. Fortement influencé par Picasso, Jacques
Innocenti, mort brutalement en 1958, usait des engobes colorés
comme un peintre de sa palette, tout en exploitant le rouge profond de
la terre brute locale. Coll. Galerie Louvre-Victoire.
l'ensemble de vases : Cérart, Cerdazur à Monaco
ont popularisé ces décors fleuris au "sgraffitto", avec
des dominantes turquoise sur fond noir ou blanc. Vallauris les a repris
à son compte, souvent de manière anonyme. La pipe avec
son fond martelé à la clef est classique de Ribero, le
vase à anses torsadées est siglé JTF, celui à
anses lisses est signé MT et le petit C. Lamarche. Coll Galerie
Kitsch.
Eté 1946. La France renaît. L'effervescence est partout.
L'art bouge. Célèbre, Picasso effarouche. Son nom est alors
synonyme d'art moderne. "Il met le nez à la place des oreilles
et les yeux à la place de la bouche." Pour beaucoup encore, "Faire
du Picasso" c'est faire n'importe quoi ! Espagnol, attiré par la
lumière et le soleil du Midi, Pablo Picasso descend cet été
1946 sur la Côte et réside à Golfe-Juan. A Vallauris,
où il visite une exposition de potiers, il fait la connaissance
de Suzanne Ramié et de son atelier Madoura. Il y modèle
quelques pièces, qu'il retrouve cuites, l'été suivant.
En 1948, il s'installe à Vallauris et aménage un vrai atelier.
Il y vivra jusqu'en 1955. Picasso devient potier. Il produira environ
4000 pièces. C'est le fruit d'une collaboration fructueuse avec
Madoura qui édite les céramiques du maître. Désormais,
Vallauris jouit d'un renom international. Bientôt, le petit village
perché devient le village des 100 potiers. Les touristes affluent.

Cliquez sur les images pour avoir accès aux légendes
Vallauris n'avait pourtant pas attendu Picasso pour être profondément
lié à la poterie. C'était une tradition qui remontait
à la nuit des temps. On dit que ce sont les Génois qui
y envoyèrent des potiers ligures venus d'Albissola, au début
du XVIe siècle. La terre est bonne, réfractaire elle supporte
assez bien la chaleur. Vallauris se spécialise alors dans la
poterie culinaire : "pignates" - marmites locales - poêlons, cruches...
sortent des fours. De Golfe-Juan, on les expédie par la mer dans
toute la Provence. A la Révolution, le village compte une quarantaine
de potiers. Un siècle plus tard, 500 tourneurs uvrent dans 46
ateliers. Ce sont des ateliers familiaux : Conil fils, Castelle-Carbonnel,
Saltalamacchia, Foucard-Jourdan, Jean Narbon, ou des sociétés
regroupant sous un nom collectif plusieurs fabricants. On y produit
la terre vernissée classique, parfois décorée de
jaspures (marbrures décoratives de différentes teintes)
et de giclures d'engobes colorés (enduit blanc ou teinté
appliqué sur la céramique pour la décorer). Le
jaune "omelette" et le vert sont les couleurs classiques de cette poterie
provençale.
  Trois
artistes font bouger les choses Trois
artistes font bouger les choses
Dès le milieu du XIXe siècle, alors que la Côte
d'Azur devient le lieu de villégiature hivernale des étrangers
fortunés, on commence à produire à Vallauris des
céramiques purement décoratives. Issus d'une ancienne famille
de potiers, deux frères, Delphin (1844-1907) et Clément
(1850-1911) Massier, fils de Jacques Massier, et leur cousin Jérôme
Massier (1850-1916) vont bouleverser les habitudes du petit village. Bénéficiant
de l'arrivée du chemin de fer à Nice (et à Golfe-Juan
en 1862), ils donnent à leur entreprise une dimension colossale
et attirent dans leurs ateliers toutes les têtes couronnées
d'Europe, hôtes privilégiés de la Riviera. Les expositions
universelles auxquelles ils participent, et où ils sont primés,
contribuent à leur notoriété. On vante leurs émaux
turquoise, bleu paon, vert jade dont ils recouvrent urnes, balustres,
amphores, aiguières,
jardinières, griffons... Toujours soucieux de nouveautés,
les Massier mettent au point des émaux à reflets métalliques
irisés. Ceux de Clément sont les plus réputés.
Parallèlement, ils créent des céramiques plus naturalistes,
des vases, des coupes en forme de fleur, des coqs, des perroquets, des
cygnes. Ceux de Delphin sont particulièrement chatoyants.
Durant l'entre-deux-guerres, remplacée par le métal, la
poterie culinaire décline. On parle désormais de poterie
hygiénique. Plusieurs marques sont déposées à
partir de 1925 : Vallaurite, Vald'Or, Val'Auror, Vallaurea... La céramique
décorative renouvelle lentement son répertoire. Au début
des années trente, sans doute pour imiter les poteries provençales
d'Aubagne, apparaît le fameux décor à la cigale sur
fond jaune d'or, puis les objets de colombins tressés : coupes,
chandeliers... Pour augmenter la production et baisser le coût,
on voit même apparaître les décors au Ripolin : des
poteries simplement peintes, souvent agrémentées d'un décor
de fleurs, mimosa ou jasmin. C'est avec ce procédé peu orthodoxe
et qui faisait hurler de rage les "vrais" potiers, que Louis Girard propose,
au milieu des années trente, des décors géométriques
abstraits, première approche d'un renouveau artistique. Dès
la fin des années trente, pendant la guerre et tout de suite après,
s'installent à Vallauris des "artistes" venus de régions
diverses. Ce sont pour la plupart des jeunes gens frais émoulus
d'une école de beaux arts, qui, parfois, viennent apprendre à
Vallauris les rudiments de la poterie et ouvrent quelques années
après leur propre atelier. Ce sont Suzanne et Georges Ramié
qui créent l'atelier Madoura, André Baud, Roger Capron et
Robert Picault qui s'associent un temps et fondent Callis, et bien d'autres
encore.
 Un
repère d'artistes pour sublimer la poterie Un
repère d'artistes pour sublimer la poterie 
Tous, ceux qui étaient déjà là ou ceux
qui s'installent, attirés par le renom subit de la cité,
voient dans l'arrivée de Picasso un formidable élan de la
création. D'autres artistes de grand renom s'essaient à
leur tour à la céramique : Chagall, Matisse, Edouard Pignon,
Anton Prinner, Victor Brauner, Amédée Ozenfant... Des liens
d'amitié se tissent. Picasso, citoyen d'honneur de la cité,
est de toutes les fêtes. C'est, pour reprendre l'expression d'Anne
Lajoix, dont l'ouvrage relate l'excitation de cette époque, "l'âge
d'or" de Vallauris.
Pourtant, tout n'est pas si idyllique dans la cité des 100 potiers.
Les anciens, ceux qui travaillaient dans les ateliers traditionnels, ne
sont pas si enthousiastes quant à l'uvre de ces créateurs,
Picasso en tête. Beaucoup n'y voient que des intellectuels inexpérimentés.
Deux clans se forment, sans contact entre eux, les locaux et les importés!
  Le
pour et le contre, mais toujours la création Le
pour et le contre, mais toujours la création
Chez les potiers traditionnels, l'imagination la plus débridée
est au pouvoir. Il faut inventer pour séduire les touristes de
plus en plus nombreux et produire toujours plus pour avoir des prix compatibles
avec ce flot de "congés payés". La découverte de
nouveaux émaux chimiques permet d'obtenir des teintes vives, vert
pomme, rouge sang, jaune citron. Vallauris se colore. On trouve alors,
en vagues successives : le bicolore, un côté noir un côté
de couleur vive; les étonnantes veilleuses, au corps éventré,
réceptacle d'algues et de poissons censés voguer dans les
fonds sous-marins. Poissons, caravelles, amphores, coquillages, moules
ou même bûche accueillant une crèche, témoignent
de cette nouvelle forme d'art populaire! On trouve ensuite les émaux
"Vésuve", dont la surface bullée, craquelée, évoque
le bouillonnement de la lave, puis les céramiques tachistes qui
perdurent jusque dans les années quatre-vingt. Toute cette production
de masse s'offre aux étalages et, d'une boutique à l'autre,
le chaland ne fait pas vraiment la différence. Car tout le monde
copie tout le monde et il suffit qu'un artisan sorte un modèle
pour que le voisin fasse rapidement la même chose. Dans les années
cinquante, les céramiques fleuries de Monaco (au moins trois ateliers
en produisent : Cérart, Cerdazur et Azureart) connaissent un certain
succès et Vallauris se met à son tour au "graffité"
(déformation du terme savant "sgrafitto"). Le décor floral
est gravé dans la terre, puis rehaussé de couleurs. Certains
ateliers s'y illustrent, Lamarche produit d'exceptionnelles soupières,
d'autres innovent, Ribero invente les fonds martelés, une clef
servant à tapoter la terre.
Toutes ces uvres, produites à des milliers d'exemplaires, s'opposent
à celles des potiers travaillant en séries plus limitées
(quoi que Capron ou Picault aient dirigé de véritables ateliers!).
Les amateurs d'aujourd'hui ne les regardent pas de la même manière
: il y a ceux sensibles à la créativité de ces années-là
et les autres, plus ou moins amateurs de kitsch, peut-être nostalgiques
de la frénésie sans borne qui animait la Côte d'Azur
et ses potiers.
Des adresses
- Alice Ceccaldi, 33, rue Auguste-Comte, 69002 Lyon. Tél.
: 78.42.59.97.
- Galerie Alexander et Klein, 115-117, Marché Malassis,
142, rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen. Tél. : 1/40.11.12.05.
- Galerie Contrastes, 46, rue Saint-Georges, 75009 Paris.
Tél. : 1/40.16.93.03.
- Galerie Kitsch, 3 rue Bonaparte, 75006 Paris. Tél.
: 1/43.29.76.23.
- Galerie Louvre-Victoire, 154, rue Saint-Honoré, 75001
Paris. Tél. : 1/40.20.07.48.
- Galerie Martel-Greiner, Marché Dauphine, allée
des Rosiers, 93400 Saint-Ouen. Tél. : 1/49.45.06.49.
Légendes des photos 
1. Le gris des pichets de Gilbert Valentin (Poterie des Archanges)
était obtenu en mélangeant sur la pièce un émail
blanc et un émail noir. Quelques touches en aplat de couleurs vives,
jaune et rouge, en faveur dans les années 50, rehaussent l'ensemble.
Coll. Galerie Contrastes.
2. Avant de se spécialiser dans la céramique
faux bois, au milieu des années 50, Grangean-Jourdan produisait
de la céramique culinaire. D'abord mat, le faux bois se décline
ensuite en version brillante, souvent agrémentée d'un
motif silhouetté noir, en particulier le profil de Sylvette,
jeune fille à la queue de cheval, modèle de Picasso. Coll.
Galerie Kitsch.
3. Plus naturalistes que les artistes de l'école de
Nancy, les Massier se sont également inspirés des fleurs
de leur jardin. Traité en barbotine, avec un grand souci de réalisme,
vase en forme d'iris de Delphin Massier. Vers 1900-1910. Coll. Alice
Ceccaldi.
4. Un graphisme léger, incisif, calligraphié,
caractérise l'uvre des années 50 de Gilbert Portanier.
Natif de Cannes, Portanier s'installe à Vallauris en 1948, après
un passage aux Beaux-Arts de Paris. Coll. Galerie Contrastes.
5. On a produit à Vallauris ces poteries usuelles
traditionnelles jusque dans les années 40-50. De gauche à
droite : cruche de Jean Michel, gargoulette de Foucard Jourdan, marmite
à queue de l'atelier Saltalamacchia. Coll. Château-musé
6. Tourneur chez Madoura, Jules Agard a travaillé
pour Picasso, dont il préparait les pièces. Sa production
personnelle, séduisant bestiaire, en a été sans
doute influencée. Coll. Galerie Alexander et Klein.
7. Typique des années 50,
ce plat d'André Baud à la couverte gris anthracite est
agrémenté d'un motif abstrait dans l'esprit de Miró.
Coll. Galerie Louvre-Victoire. 
8. Dès le milieu des années 30, on a produit
à Vallauris ces coupes en céramique tressée. Celles
de Jérôme Massier sont généralement réalisées
à partir de colombins lisses et aplatis. On trouve également
des modèles torsadés, souvent plus tardifs. Coll. Alice
Ceccaldi.
9. A l'opposé du "Vallauris de Picasso", les anciens
ateliers ont proposé aux touristes des souvenirs au goût
parfoisdouteux. Fabriqués manuellement (tous les poissons étaient
collés un à un à l'intérieur) ces poissons-veilleuses
restent une des images fortes du Vallauris des artisans traditionnels.
Modèle de Ribéro. Coll. Galerie Kitsch.
10. Décorateur chez Madoura, Jean Derval a été
en contact avec Picasso dont il a retenu l'ampleur des formes et la
puissance du graphisme. Cette tête de femme découpée
évoque le géométrisme figuratif en faveur dans
les années 40-50. Coll. Galerie Contrastes.
Extraits de l'article de Pierre Faveton paru dans Art et Décoration
n° 343 (Photos Christophe Raynaud de Lage)
|